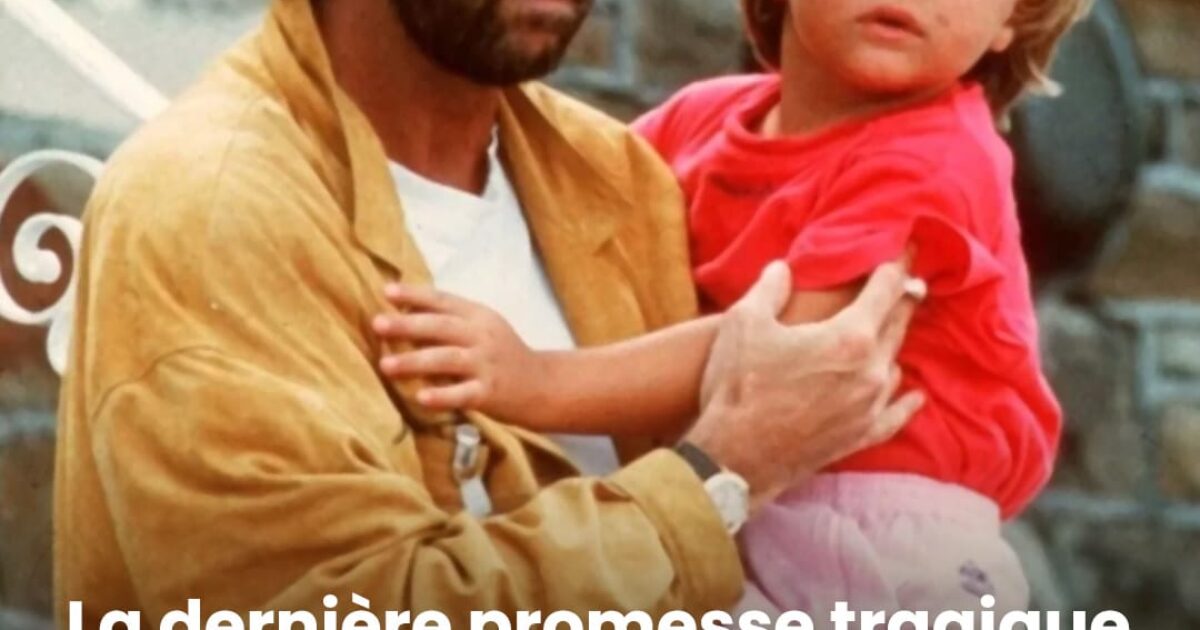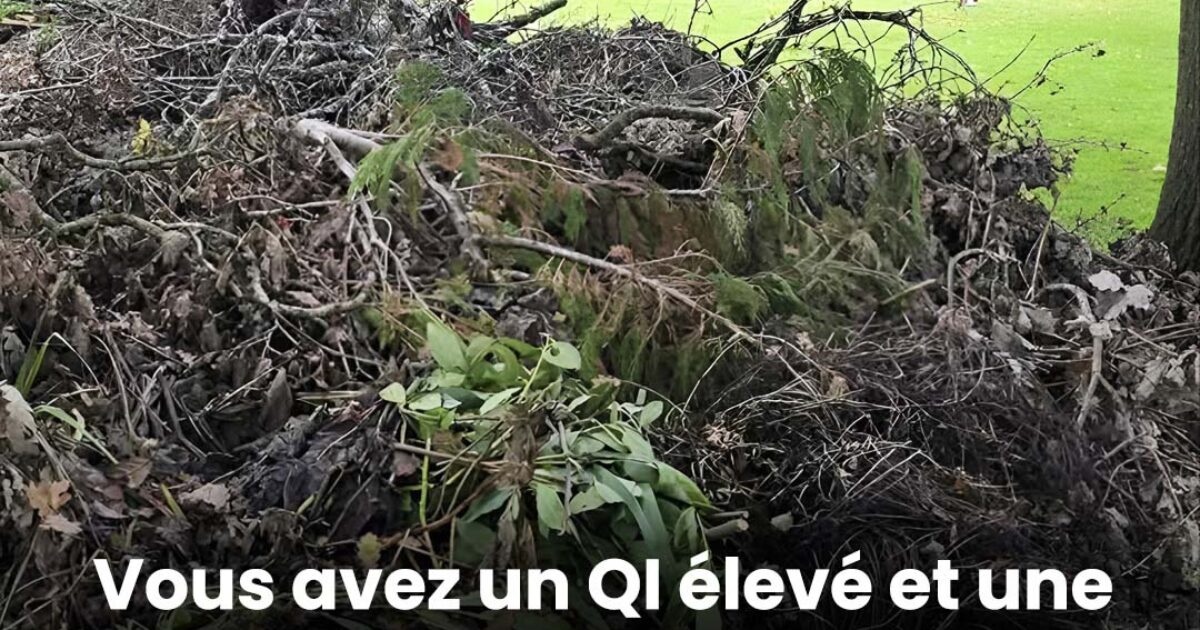Un « bonjour » en français fait scandale en Flandre : la guerre des langues relancée

En Belgique, un simple salut en français dans un train flamand a déclenché une tempête politique. Derrière cette plainte insolite se cache un conflit linguistique ancestral qui divge toujours le pays.
« `html
Un petit mot qui en dit long

Tout commence avec Ilyass Alba, chef de bord à la SNCB (les chemins de fer belges). Alors qu’il effectue un trajet vers Vilvorde, en région flamande, il entame son annonce en néerlandais avant d’ajouter un innocent « bonjour » en français. Ce qui semblait être une marque de politesse basique va pourtant déclencher une polémique inattendue.
En Flandre, la législation impose strictement l’usage exclusif du néerlandais dans les communications officielles. Un passager particulièrement sourcilleux y voit donc une violation des règles et décide de porter plainte. Oui, vraiment, pour un seul mot prononcé avec le sourire.
Une plainte qui fait jurisprudence

La Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) donne raison au plaignant, rappelant que la loi prime sur toute considération de courtoisie. Dans son verdict, elle souligne que « l’expérience client » ne saurait justifier le moindre écart linguistique.
De quoi laisser perplexe Ilyass Alba, qui s’exprime sur les réseaux : « Où va-t-on si on ne peut même plus dire bonjour ? N’avons-nous pas perdu le sens des priorités ? » Son cri du coeur trouve un écho massif, bien au-delà des frontières belges.
Le révélateur d’une fracture nationale
Pour saisir toute la portée de cet incident, il faut comprendre les tensions historiques entre la Wallonie francophone et la Flandre néerlandophone. En Belgique, la langue n’est pas qu’un outil de communication – c’est un marqueur identitaire chargé d’histoire et d’émotions.
Ce « bonjour » malheureux agit comme une étincelle sur une poudrière linguistique toujours prête à s’enflammer. Pourtant, l’intention du contrôleur était des plus pures : simplement créer un moment de connection humaine dans le cadre strict de son travail.
Quand la loi étouffe la spontanéité

Heureusement, la SNCB a finalement classé l’affaire sans sanction, mettant fin à cette étrange saga. Mais le débat, lui, continue de faire rage. Cette histoire pose une question fondamentale : peut-on vraiment légiférer sur chaque syllabe échangée dans l’espace public ?
Dans un pays où les frontières linguistiques sont si poreuses, n’y aurait-il pas place pour un peu plus de souplesse ? Et si ces petits mots d’apparence anodine étaient justement ce qui pourrait réconcilier les communautés plutôt que les diviser ?
« `